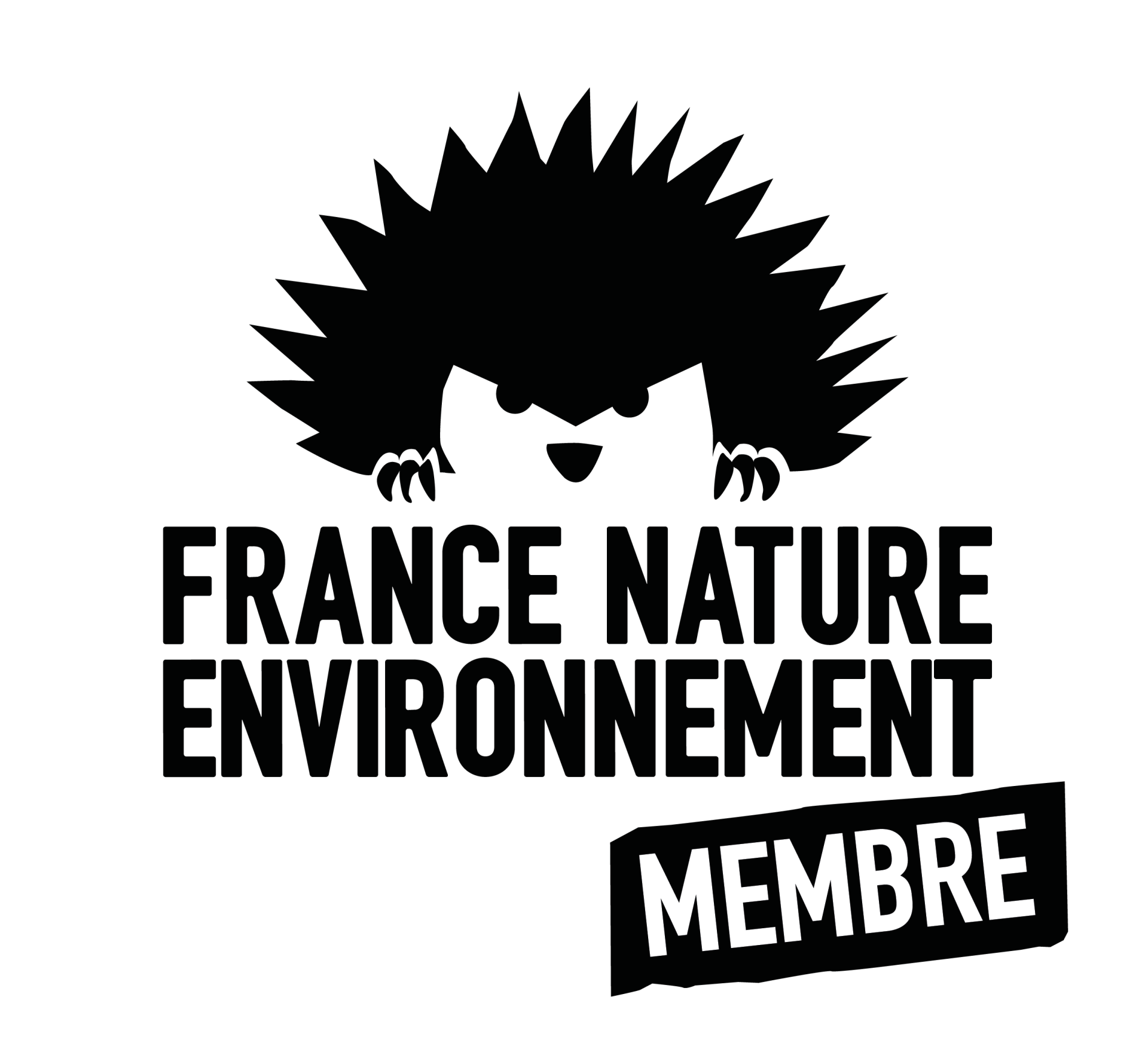La réunion publique qui s'est tenue le 02 juin à Arles a permis de démontrer que la solution enterrée et sous-marine est une alternative crédible pour concilier transition énergétique et préservation des territoires.
06.06.25
Alors que le projet de ligne à très haute tension (THT) entre Jonquières-Saint-Vincent (Gard) et Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) cristallise toujours plus les tensions depuis des mois, la solution alternative portée par le collectif THT 13-30 gagne du terrain. Lors de la réunion publique du 2 juin à Arles, près de 800 personnes agriculteurs, élus, associations environnementales ont réaffirmé leur opposition au tracé aérien de RTE, jugé "dévastateur" pour les paysages et la biodiversité, et plébiscité l’enfouissement et l'ensouillement des câbles comme solution viable.
Un projet aérien toujours contesté
Le projet initial de RTE prévoit 180 pylônes de 50 à 90 mètres de haut sur 65 km, traversant des sites classés en Terre d'Argence, Camargue et dans la plaine de la Crau) pour alimenter le pôle industriel de Fos-sur-Mer. Malgré son objectif de décarbonation, il suscite une levée de boucliers unanime.
"Personne ne peut accepter le projet tel qu'il est présenté aujourd'hui" a indiqué Patrick de Carolis, maire d'Arles et président de la Communauté d'Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette en introduction de cette réunion.
" La Camargue, c'est le pays du souffle, prenons garde à ce que ce ne soit pas le pays de la colère" a-t-il ajouté.
L’alternative du collectif THT 13-30 : enfouissement et ligne sous-marine
Face à ce projet, le collectif THT 13-30 propose une solution technique et moins intrusive :
- Liaison Jonquières-Fos avec enfouissement des câbles le long des digues du Rhône, évitant les terres agricoles (tracé violet sur la carte)
- Relance d’un projet sous-marin abandonné par RTE (ligne "Midi-Provence" en Méditerranée) (tracé violet sur la carte
Jean-Laurent Lucchesi (Vigueirat Nature) a présenté de manière détaillée notre solution. Ses arguments ont été appuyé par un travail d'échelonnement des besoins en énergie de la ZIP de Fos. Ainsi, avec un renforcement du réseau RTE en cours, la puissance acheminée peut être de 1.2 GW d'ici 2028. En réalisant la ligne Jonquières-Fos en enterrée, la puissance monte à 3.2 GW en 2032. En s'appuyant sur une solution complète avec production d'hydrogène, la relance de Midi-Provence et la récupération de l'énergie des éoliennes offshore, notre solution offre une capacité de 8.2 à 9 GW d'ici 2035.
Nous avons le choix entre une "simple ligne électrique" et un véritable projet de territoire
A l'issue de la présentation de la tierce expertise par M. Marc Petit, ingénieur à l'école Centrale Supelec, Jean-Luc Moya nous a présenté les principaux enseignements de celle-ci :
- La solution portée par le Collectif THT 13/30 est jugée pertinente sur le plan technique
- L'étude considère qu’il y a une probabilité non nulle d’un décalage dans le temps de certains projets (Hydrogène)
- La capacité du réseau est envisagée de manière évolutive dans le temps : 2026/2030 et 2028/2035
- Réactualise le projet Midi-Provence et cite un projet similaire : GILA (Gironde Loire Atlantique → Bordeaux Nantes en sous-marin • mise en service en 2033)
Mais :
- Elle propose une vision « techniciste » sans prise en compte des impacts d’une ligne aérienne au niveau de la biodiversité, terres agricoles, économies, paysages
- Mais n'intègre pas la question de l’acceptabilité sociale du projet au sein des territoires du Gard, de Camargue et de Crau
La comparaison des 2 solutions, celle de RTE et celle du Collectif THT13/30 met en avant notre solution.

Au niveau des impacts sur l'avifaune, notamment, soulignons l'intervention de François Cavallo, qui, à travers les différents comptages réalisés en 2024 montre l'extrême richesse de nos territoires.
Rien n'a été décidé selon M. Le Préfet
En conclusion de ces nombreux et longs échanges, le préfet de région, Georges-François Leclerc, a assuré qu’"aucune décision n’est actée". Dont acte.
Si l’État persiste avec le tracé aérien, le Collectif THT13/30 promet des recours en cascade. "Cette ligne ne verra jamais le jour, on ira jusqu’à la guerre !", a ainsi tonné Clément Lajoux, porte-parole des agriculteurs.
Alors que la transition énergétique ne peut se faire au mépris des territoires, la solution enterrée et immergée apparait comme un compromis réaliste. Reste à savoir si RTE et l’État sauront écouter cette voix médiane, sous peine d’envenimer un conflit déjà explosif.
Découvrez les autres interventions
Raphaël Mathevet, Directeur de recherche au CNRS
De Raphaël Mathevet, Directeur de recherche CNRS et Directeur d’Etudes EPHE UMR CEFE Montpellier - Université Montpellier – Université Paris Sciences & Lettres
__________
Mesdames et Messieurs, Merci de votre invitation.
Pour être tout à fait transparent, je suis codirecteur de la Zone Atelier « Santé Environnement Camargue » du CNRS, Coprésident du Conseil Scientifique du Parc naturel régional de Camargue, et expert pour le programme l’homme et la biosphère de l’Unesco – et membre de conseils scientifiques nationaux liés à la protection de la nature ou à la recherche scientifique.
J’interviens cependant ici à titre individuel, en spécialiste des dynamiques sociales et écologiques de ce territoire étudié depuis une trentaine d’années.
L'enjeu de décarbonation étant un consensus, je n'y reviens pas. Ceci étant posé...
Mesdames et Messieurs, la philosophe Simone Weil nous a enseigné que l'enracinement est un besoin essentiel de l'âme humaine. La Camargue, terre de traditions et de nature entremêlées, incarne cet enracinement. Aujourd'hui, cet écosystème précieux est menacé par le projet de ligne à très haute tension qui risque d'altérer durablement son paysage et de porter atteinte à son essence même.
D’abord, je voudrais rappeler que la Camargue actuelle est le fruit de choix délibérés fin 19ème et début 20ème siècle, de choix résistants à l'uniformisation agricole. Son identité unique, portée par Folco de Baroncelli, a fondé un profond attachement culturel. Cet élan a nourri une alliance d'acteurs locaux – propriétaires, éleveurs, chasseurs, scientifiques, protecteurs de la nature – qui ont tous œuvré pour préserver sa mosaïque paysagère : agricultures, marais vivants, traditions vivantes. Cette diversité est la clé de sa résilience face aux changements.
Plus tard, Luc Hoffmann et Olivier Guichard furent décisifs pour créer le Parc Naturel Régional en 1973, en contrepoint aux grands aménagements industriels de Fos et touristiques du Gard. Nous dirions aujourd’hui que le Parc était une forme de compensation aux aménagements lourds de l’époque. L’importance écologique mondiale de la Camargue justifie votre attention, cette attention nationale et internationale.
Ce legs est confronté à des enjeux écologiques majeurs, ce sera mon second point. La ligne THT aérienne entraînerait fragmentation paysagère et artificialisation sur plusieurs dizaines de kilomètres. L'impact sur l'avifaune serait critique : la Camargue est un sanctuaire pour d'innombrables espèces, très vulnérables aux lignes, aux risques d’électrocution et de collision. Ces risques s'ajouteraient aux effets cumulés d'autres aménagements régionaux à Fos-sur-Mer ou à l’éolien en mer.
Plus encore, le projet contrevient manifestement aux missions premières du Parc, inscrites dans sa charte, et menace l'intégrité des sites Natura 2000 et de la Réserve mondiale de biosphère de l’UNESCO. Les risques de contentieux juridiques et sociaux sont donc très élevés, impactant durablement tout déploiement du projet.
Troisièmement, les répercussions socio-économiques seraient profondes. Identité locale, modes de vie, attachement puissant des populations seraient affectés. Économiquement, le tourisme, pilier majeur, serait durablement impacté par la dégradation visuelle. L'agriculture de qualité et l'élevage seraient aussi touchés. Ces impacts soulignent le besoin d'un projet territorial de grande ampleur, concerté, pour penser la diversité des vocations des zones concernées en Camargue et bien au-delà (Terre d’Argence, Crau, Fos, Berre, etc.).
Pour conclure, Mesdames et Messieurs, ce projet est un choix de société crucial. Allons-nous imposer des infrastructures lourdes et leurs conséquences dans l'un des espaces les plus protégés de France ? Ou adopter une approche intégrée, respectueuse ? Pour éviter la maladaptation climatique et promouvoir la sobriété énergétique, il s’agit de dépasser l'approche technique pour considérer valeurs patrimoniales et sociales. J'appelle donc, avec nombre de mes pairs, à une réévaluation complète.
Celle-ci demande :
→ Premièrement, des études d'impact rigoureuses sur la biodiversité, les risques de collision de l'avifaune notamment les passereaux, intégrant les effets cumulés de tous ces projets. Cela demande de prolonger les débats, tenir compte des échéances réalistes des projets industriels et reconsidérer l'échéance 2028-2030 à la lumière de l’approche par étapes proposée par M. Marc Petit.
→ Deuxièmement, une analyse coûts-bénéfices réellement complète, incluant les coûts environnementaux, sociaux et patrimoniaux tout secteur d’activité confondu.
→ Troisièmement, une étude approfondie des scénarios alternatifs et solutions
mixtes enfouissement/aérien, évaluant toutes leurs conséquences, l'enfouissement même partiel redéfinissant fondamentalement le « fuseau de moindre impact » actuel.
L'heure est à un aménagement authentiquement participatif, où les instances de débats doivent jouer leur rôle, pour intégrer toutes les dimensions humaines et sociales. Les valeurs des habitants doivent pénétrer la sphère gestionnaire et politique. C'est la condition de décisions éclairées.
Car, et je citerai à nouveau le travail de la philosophe Simone Weil pour qui l'obéissance à une collectivité – quelle qu’elle soit - est un mal si cette collectivité ne conserve pas réellement, et ne transmet pas réellement, certains trésors du passé et certains pressentiments de l'avenir.
Assurons-nous que nos décisions, vos décisions pour la Camargue soient dignes de cet impératif.
Je vous remercie.
Gaël Hemery, Directeur Réserve Naturelle Nationale de Camargue
De Gaël Hemery, pour le compte des gestionnaires d'espaces naturels
_____
Je m’exprime ici au nom des gestionnaires des espaces naturels protégés réglementairement de Camargue et de la Crau qui interviennent sur près de 25 000 ha.
Notre expertise porte sur la connaissance du fonctionnement de ces milieux naturels, de leur faune et leur flore. Mais nous sommes aussi acteurs du lien intime que ces territoires protégés tissent autour d’eux avec les agriculteurs, les éleveurs, les visiteurs et les habitants.
La note complémentaire de Mr Petit apporte un éclairage intéressant sur la question de l’urgence à créer la ligne mais aussi sur la volatilité de l’activité économique associée. En indiquant que le meilleur choix technique est la solution uniquement aérienne entre Jonquières et la Feuillane, il prend bien soin de préciser je le cite « en dehors des impacts paysagers et avifaune ». Pour nous ce n’est pas « en dehors » mais bien au cœur du sujet.
Nous tenons à rappeler où nous sommes et d’où nous venons. Ce qu’on appelle le triangle d’or de la biodiversité est le fruit de plusieurs millénaires d’actions du Rhône, de la Durance et de la mer. Joyau de la France ces ensembles naturels constituent des exceptions, uniques et plutôt en bon état entre Barcelone et Gênes. Dès 1942, avec le site classé Camargue qui érige ce territoire au rang de monument naturel au titre de la loi paysage de 1930, un long processus de politiques publiques va mettre en place une protection dont la plus récente est la reconnaissance à un niveau international comme Réserve de biosphère.
Pourquoi ?
- Parce ce territoire comprend, la plus grande zone humide de France , premier quartier d’hivernage des oiseaux d’eau du territoire métropolitain, une véritable plateforme entre l’Afrique et l’Europe pour des millions d’oiseaux qui transitent et cherchent une halte reposante. Pour 14 espèces d’oiseaux ce territoire revêt une importance internationale.
- Parce qu’il comprend également les derniers reliquats de la dernière plaine steppique d’Europe, la Crau, qui accueille des espèces qui font l’objet de plusieurs plans nationaux d’actions (outarde canepetière, vautour percnoptère, ganga cata, aigle de Bonelli, alouette calandre).
- Parce qu’il accueille des paysages, des cultures et des savoirs-faires exceptionnels qui ont été reconnus et valorisés par la création de deux parcs naturels régionaux dont les chartes affirment la vocation de ces territoires à être tenu à l’écart des grands aménagements notamment énergétiques.
Nous estimons donc que ce patrimoine que nous protégeons depuis plusieurs décennies pour le compte de la société doit être considérée comme un enjeu public majeur, d’une importance au moins équivalente à celui de la décarbonation qui motive le projet.
A qui viendrait l’idée d’installer une ligne très haute tension devant le Mont St Michel ou une éminente cathédrale de France? La note de Mr petit pointe aussi l’intérêt de la solution enfouie, certes plus complexe et onéreuse mais qui intègre un pas de temps plus raisonnable, au vu des incertitudes qu’il pointe sur l’évolution de certaines technologies.
Nous pronons donc pour cette solution qui évite l’aérien et les dommages irréversibles qu’elle causerait au triangle d’or de la biodiversité mais aussi au territoire dans son ensemble, notamment sur le plan agricole et touristique. Cependant nous tenons à indiquer que nous serons disponibles et ouverts à collaborer pour diminuer au maximum les impacts de la solution enfouie car nous sommes conscients aussi qu’il n’y aura pas de solutions sans dommages.
Nous pensons que cette solution, si elle est bien conduite, pourrait être une réussite
pour le territoire et sa participation à la transition écologique. Et éviterait de vivre celle-ci comme une altération existentielle de ces richesses et de son histoire.